L'HYPERSENSIBILISATION au FORMING GAS
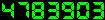

Les pellicules photographiques
Dans cet article nous nous intéressons essentiellement à la photographie astronomique argentique noir et blanc.
La photographie des objets célestes de faible éclat a des exigences différentes de la photographie classique. Ces astres ont souvent des couleurs qui n'impressionnent pas, ou peu, les films habituellement rencontrés dans le commerce. Exemple : Le film TMAX de KODAK n'est pas sensible à la lumière rouge de la raie H-alpha de l'hydrogène (656,3nm), or cet élément est le constituant essentiel de l'univers et cette raie est émise par de nombreux objets célestes.
Mais le problème le plus grave est que les films classiques sont étudiés pour des temps de pose compris entre 1/1000 de seconde et une seconde. Ceci est à peu près le domaine de définition de la sensibilité selon la norme ISO. Pour d'autres durées d'exposition, ils n'obéissent pas à la loi de réciprocité. Celle-ci indique que pour obtenir un noircissement donné sur le film, le temps d'exposition nécessaire est inversement proportionnel à la luminosité de l'image à enregistrer.
Autrement dit : supposons qu'une scène soit correctement exposée en 1/100 de seconde. Si la luminosité est réduite de moitié, par exemple à cause d'un nuage, alors le temps de pose doit être doublé. Il sera de 1/50 de seconde. On doit doubler le temps de pose quand on réduit la luminosité de moitié afin de procurer une même quantité de lumière à la pellicule. C'est le raisonnement habituel de tous les photographes.
Hélas lorsque le temps de pose est grand, les choses se compliquent : si la luminosité est réduite de moitié, le temps de pose devra être supérieur au double pour avoir un noircissement équivalent.
Au-delà d'un certain temps de pose, il n'y a plus réciprocité entre la luminosité et la durée de l'exposition correcte. Ce temps de pose limite a une valeur différente pour chaque type de film. Voyons tout d'abord ce que l'on peut obtenir avec les films classiques. Nous désignons sous ce terme les émulsions que l'on trouve habituellement dans le commerce et qui n'ont pas été étudiées pour l'astronomie.
Nous avons pris des clichés du ciel nocturne avec du TRI-X, du TMAX400 et du HP5. Ce sont des films classiques Noir & Blanc de 400 ISO. Malgré leur défaut de réciprocité, ils ont une bonne sensibilité, mais d'autres caractéristiques les rendent indésirables en astronomie. Sur ces clichés, les détails sont estompés car les films ne sont pas assez contrastés. Les objets astronomiques sont souvent peu contrastés, il faut donc un film très énergique pour rendre leur contemplation agréable. La granulation est prononcée. Elle porte un grand préjudice à la qualité des photographies.
Un autre grand défaut est la sensibilité spectrale insuffisante. Certains astres sont désespérément absents des clichés car ces émulsions ne sont pas sensibles à une partie des rayons lumineux rouges.
Introduction à la sensitométrie
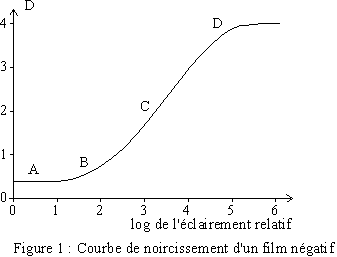
L'astronome amateur qui souhaite photographier les astres doit avoir un minimum de connaissances en sensitométrie. Il doit savoir interpréter la courbe de noircissement d'une émulsion.
La figure 1 représente la courbe de noircissement d'un film négatif, il est très important de savoir l'interpréter. Elle décrit l'évolution de la densité optique de l'émulsion en fonction de l'éclairement reçu avant le développement. La densité du film est une grandeur qui traduit le noircissement. Plus le film est noirci, plus sa densité optique est grande. La densité D est égale au logarithme décimal de l'opacité.
Voici l'interprétation des différentes parties de la courbe :
-
A - Même en l'absence d'éclairement l'émulsion n'est pas parfaitement transparente après le développement. Il y a un léger voile et le support absorbe lui aussi un peu de lumière.
B - A partir d'un certain seuil, le film noircit d'autant plus qu'il reçoit de la lumière. C'est le pied de la courbe.
C - A parti d'une autre valeur, l'opacité du film est proportionnelle à l'éclairement qu'il a reçu, c'est la partie linéaire de la courbe. C'est toute cette partie qui est utilisée pour la photographie classique. Mais c'est dans le bas de cette zone que les émulsions ont les meilleures performances, c'est là que le rapport signal sur bruit est le meilleur. La densité pour le meilleur rapport signal sur bruit est comprise entre 0,5 et 1 suivant les films. La pente de cette partie linéaire caractérise le contraste du film : une forte pente correspond à un fort contraste.
D - Au-delà de la partie linéaire, il y a saturation. Cela se passe vers D=3 à 4.
Dans la suite de cet article nous nous intéresserons à la partie basse de la courbe, jusqu'à D=2, elle est la plus intéressante pour nous.
Afin de pouvoir comparer des essais réalisés avec des temps de pose différents, nous considérerons maintenant la lumination à la place de l'éclairement. La lumination est la quantité de lumière reçue. Le film peut obtenir la même lumination avec un fort éclairement pendant une courte exposition ou avec un faible éclairement pendant une longue durée.
Voici maintenant, sur la figure 2 une courbe de noircissement réelle. C'est celle du TMAX400 développé dans du révélateur TMAX. Elle a été tracée pour un temps de pose de 1,8s.
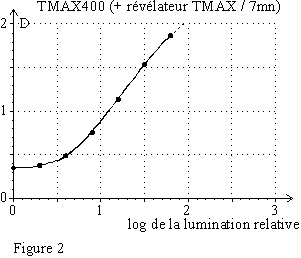
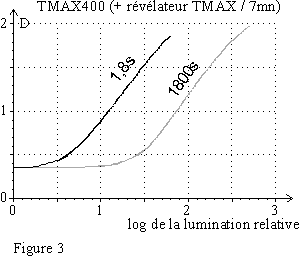
Sur la figure 3, nous voyons la même courbe juxtaposée avec la courbe relative à une pose de 1800s, soit une demi-heure sur le TMAX400. Cette pose était mille fois plus longue mais l'éclairement du film était réduit dans les mêmes proportions. Ainsi la pellicule a reçu la même quantité de lumière.
Ces courbes sont décalées à cause du défaut de réciprocité. Moins le film est sensible, plus sa courbe est décalée vers les forts éclairements, c'est à dire vers la droite. En interprétant ces graphiques nous constatons que le TMAX400 est 6 fois moins sensible pour les temps de pose de une demi-heure. Vous comprenez donc que la sensibilité en ISO (anciennement en ASA), qui est indiquée par les fabricants nous renseigne mal pour les clichés à longue pose. Elle peut même nous faire constater des contradictions car, pour les longues poses, un film de 100ISO peut être plus sensible qu'un film de 400ISO.
Pour les faibles éclairements la sensibilité dégradée de ces films peut imposer des temps de poses aberrants. Certains astres faiblement lumineux sont impossibles à photographier avec ces émulsions.
Les plus anciens astronomes amateurs que nous avons rencontrés ont connu le temps des plaques SUPER-FULGUR sur lesquelles des poses de plusieurs heures permettaient d'enregistrer des images granuleuses. Le mérite de ces vétérans était grand car ils ne disposaient presque jamais d'entraînement motorisé sur leur télescope. Plus récemment les amateurs utilisaient les films spectroscopiques KODAK de la série 103 qui comprend des émulsions de sensibilités spectrales différentes. Les plus utilisés étaient le 103aE (spectre visible + rouge profond), le 103aF (spectre visible) et le 103aO (bleu). Le défaut de réciprocité de ces pellicules était faible mais leur granulation était trop importante.
Au cours des années 70, la firme KODAK a sorti un film aux propriétés quasi-miraculeuses.
- · Sensibilité spectrale plate depuis le proche ultraviolet jusqu'au rouge profond.
- · Grain très fin qui lui permet de supporter de forts agrandissements.
- · Fort pouvoir résolvant env. 330 traits/mm.
- · Contraste modulable dans de grandes proportions (0,7 à 3,5 suivant le révélateur).
- · Très grande stabilité des dimensions du support.
- · Pas cher, facile à trouver.
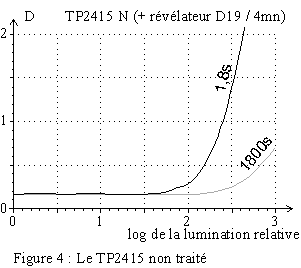
C'est le TP2415 (Vous pouvez étudier les caractéristiques de ce film sur le site des Observatoires d'Augerolles et de Cunlhat).
Hélas il n'a pas que des avantages, ce film a un défaut de réciprocité très marqué au-delà de quelques secondes de pose. Notez aussi qu'il se "gondole" volontiers lorsque l'air est humide, ce qui rend parfois son emploi très désagréable.
Ce film est quand même extraordinaire, et il réagit très bien à la plupart des traitements d'hypersensibilisation, notamment au forming gas.
La figure 4 montre le défaut de réciprocité important de ce film. Lors de la pose d'une demi-heure la sensibilité est réduite au quart de la valeur initiale. Cette carence interdit l'utilisation de ce film pour les longues poses, à moins qu'on l'hypersensibilise.
L'hypersensibilisation est un terme qui désigne les techniques destinées à réduire le défaut de réciprocité ou à augmenter la sensibilité d'une émulsion pour la rendre plus performante aux faibles éclairements. Voici les méthodes les plus répandues dans le petit monde des amateurs d'astronomie :
Préflashage : On illumine légèrement le film avant l'exposition, cela augmente la sensibilité aux faibles éclairements au détriment du contraste.
Refroidissement : Le défaut de réciprocité diminue avec la température... et la sensibilité aussi. Il faut donc refroidir l'émulsion sans excès durant son exposition. La température se situe habituellement vers -20°C. Cette technique donne des résultats très intéressants surtout pour les films couleurs, mais elle est délicate à mettre en œuvre. Il faut faire face notamment à des problèmes de givre. Notez que parfois les nuits sont suffisamment fraîches pour profiter de cette propriété sans matériel spécialisé.
Hypersensibilisation au nitrate d'argent (AgNO3) : Cette technique consiste à tremper le film dans une solution de nitrate d'argent juste avant l'exposition. Ceci est très efficace et n'exige pas de matériel sophistiqué, mais il faut être très habile pour obtenir un résultat régulier et reproductible. Sa mise en œuvre peut être très délicate pendant les nuits fraîches, car le traitement doit se faire à 20°C et il faut faire sécher rapidement le film avant l'exposition.
Hypersensibilisation au forming gas : Cette technique s'apparente à la précédente mais le trempage est effectué dans un gaz. Il s'agit d'un mélange d'hydrogène et d'azote. Elle a beaucoup de succès car elle est relativement simple, facile à maîtriser et les films traités peuvent être conservés plusieurs mois au congélateur. Elle est à la portée de tous et de toutes les bourses. C'est une application de cette méthode que nous allons vous présenter, nous l'utilisions depuis 1981.
Le forming gas doit son nom à des chercheurs américains. Ceci explique son orthographe.
La sensitométrie
La sensitométrie est l'ensemble des techniques destinées à étudier les propriétés des surfaces sensibles.
Pour obtenir des clichés beaux et exploitables, l'astronome (amateur ou professionnel) doit évaluer la sensibilité et le contraste des films qu'il utilise. Ce besoin est impératif s'il emploie des pellicules hypersensibilisées. Dans ce cas, il doit contrôler l'efficacité du traitement ou la qualité de la conservation prolongée de ses émulsions. Dans ce chapitre nous allons vous présenter notre méthode.
Nous exposons sur la figure 5 le dispositif que nous avons conçu pour illuminer un film à travers une gamme de gris par transmission (KODAK photographic step tablet N°1A). Celle-ci possède onze plages dont la densité optique évolue de 0,05 à 3,05 par pas de 0,3. L'éclairement du film à travers elle subit donc la même progression.
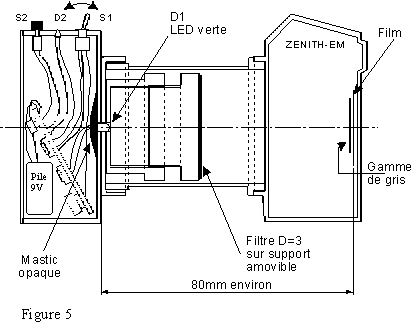
La source lumineuse est une LED verte (D1) commandée par un circuit électronique temporisé. Une pression brève sur le bouton S2 entraîne l'illumination de la LED D1 pour une durée de 1,8 ou 1800 seconde suivant la position du bouton S1. Le voyant de contrôle D2 permet de vérifier le fonctionnement et de constater la fin de la pose. Pour les poses de 1800s nous interposons devant D1 un filtre gris neutre de densité 3 (filtre KODAK WRATTEN N°96 de densité 3). Dans ce cas l'éclairement du film est mille fois plus faible alors que la durée de pose est mille fois plus longue. Le film reçoit la même quantité de lumière. Le dispositif amovible qui porte le filtre se visse à l'intérieur de la chambre noire. Ce support est réalisé de façon à être bien étanche à la lumière.
Le choix du boîtier photo n'est pas important mais celui-ci doit posséder un obturateur mécanique car les poses de longue durée usent rapidement les piles des appareils à obturateur électronique. Nous utilisons un vieux ZENITH-EM. Nous avons collé la gamme de gris sur la glissière du film. L'obturateur doit rester ouvert pendant toute la pose. Faites attention à la lumière parasite qui peut entrer par le viseur.
Nous ne donnons pas plus de détails, chacun fera selon ses possibilités et son inspiration.
Le circuit électronique du sensitomètre
Il s'agit d'un circuit, alimenté par une pile de 9 Volts, qui commande l'éclairement du film grâce à une LED. Nous avons choisi une LED verte, ceci pourra poser des problèmes si vous voulez tester des films qui sont peu ou pas sensibles à cette couleur (Exemple : Le film 103aO).
Une seconde LED, D2 de couleur rouge, est visible de l'extérieur du boîtier. Elle s'illumine en même temps que la précédente et sert de témoin de fonctionnement. Elle ne s'éclaire que lorsque la tension de la pile est supérieure à 7 Volts. En dessous de cette valeur l'éclairage de la LED verte D1 n'est plus constant, il faut changer la pile.
Pendant l'exposition la consommation vaut environ 25mA ensuite elle est nulle, il n'y a donc pas de bouton marche-arrêt. Notez que le circuit imprimé est prévu pour recevoir différents types de condensateurs, vous trouverez donc des trous supplémentaires.
Nous utilisons ce dispositif pour exposer nos films pendant 1,8 ou 1800 secondes. Eventuellement, le tableau suivant vous indique avec quelle broche de IC2 il faut connecter le point A pour obtenir des durées intermédiaires (les valeurs sont arrondies).
| N° broche IC2 | |||||||||||
| Temps de pose (s) |
Avant le premier essai, vérifiez tout d'abord vos soudures, ensuite contrôlez l'orientation des composants (circuits intégrés, diodes, transistors). Pour le réglage nous vous proposons de souder momentanément un fil entre le point A et la broche 13 de IC2. S1 doit être en position 1800 secondes. Appuyez sur S2, Les LED doivent s'illuminer pendant 28 secondes, ajustez cette durée an agissant sur P1 (ensuite n'oubliez pas de retirer le fil).
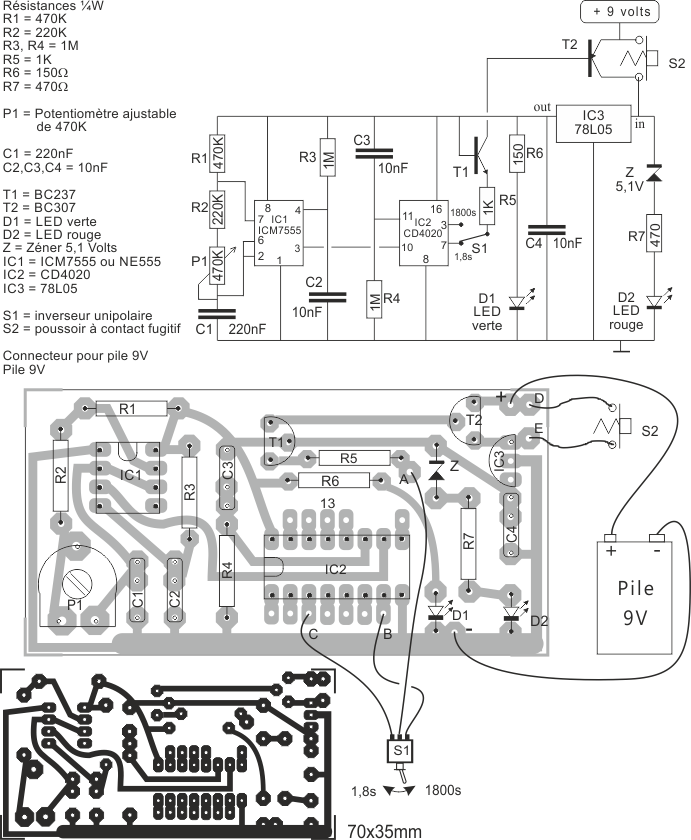
Vous trouverez les composants auprès des distributeurs de composants. Pour des achats par correspondance vous pouvez éventuellement contacter la société CONRAD.
Le dessin de ce circuit le représente vu depuis le côté composants.
Commencez par vérifier l'état de la pile (D2 doit s'illuminer quand vous appuyez sur S2). Chargez le film à tester, faites-le avancer de trois vues. Le cas échéant, enlevez le filtre puis positionnez le déclencheur du boîtier en pose T (ou en pose B + déclencheur souple à blocage). L'interrupteur S1 doit être positionné pour une durée de 1,8 secondes.
Ouvrez l'obturateur puis déclenchez la pose en appuyant brièvement sur S2.
Dès que la pose est terminée, fermez l'obturateur et avancez le film d'une vue. Installez le filtre gris neutre de densité 3 devant la LED verte D1 et basculez le bouton S1 en position 1800 secondes.
Ouvrez l'obturateur et déclenchez la pose en appuyant sur S2.
Une demi-heure plus tard la pose prend fin. Fermez l'obturateur.
Le film, lors du second cliché, est mille fois moins éclairé mais son exposition est mille fois plus longue. Vous disposez donc de deux clichés ayant reçu la même quantité de lumière avec des temps de pose très différents. Après développement ils auront des noircissements différents si le film présente un défaut de réciprocité sensible pour des poses de 1 seconde à 30 minutes.
Mesure de densité sur un négatif
Nous vous proposons d'utiliser un posemètre à mesure ponctuelle pour agrandisseur (nous utilisons un posemètre PHILIPS PDT 022).
Plaçons la cellule du posemètre sous l'agrandisseur sans mettre de film dans le passe vue. A partir de cet instant nous ne déplaçons plus la cellule, elle restera à cet emplacement pendant toute la séance de mesure. L'éclairage éventuel du laboratoire doit être éteint. Réglons ensuite le diaphragme de l'objectif ou la sensibilité du posemètre pour que celui-ci indique un temps de pose de 1 seconde.
Installons ensuite le négatif à mesurer dans le passe vue. La zone de l'image que nous voulons mesurer doit être projetée sur la sonde du posemètre. Pour cela nous ajustons la position du négatif dans le passe vue. Le posemètre indique alors un temps de pose en secondes qui est numériquement égal à l'opacité de cette zone. La densité correspondante est le logarithme décimal de cette valeur.
Exemple : si le posemètre indique 2 secondes, c'est que la partie
étudiée du négatif ne laisse passer que la moitié
de la lumière incidente.
Autrement dit, la transmission en ce point
est T = 1/2 et l'opacité est O = 1/T = 2.
La densité est D = -log10(T) = log10(O) = 0,30.
Nous notons les mesures effectuées sur chaque zone de l'image de la gamme de gris et nous les reportons sur un graphique analogue à la figure 2. Sur celle-ci nous avons marqué les points de mesure. La zone la plus sombre de la gamme de gris correspond à la plus claire du négatif et à la position zéro de l'axe horizontal du graphique. La plage suivante se rapporte à la position 0,3 de cet axe. Et ainsi de suite, chaque fois que l'on passe à la zone suivante on progresse de 0,3 sur l'axe représentant le logarithme décimal de la lumination relative.
Notez qu'il est préférable de déplacer le film dans le passe vue et garder la sonde au même emplacement sur le plateau de l'agrandisseur. En procédant ainsi, on évite les erreurs dues aux irrégularités de l'éclairement de l'agrandisseur telles que l'extinction sur les bords du champ.
La lumière issue des parties claires du négatif, en se diffusant, peut perturber la mesure des parties les plus sombres. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à cacher les parties claires du négatif lors des mesures des zones de forte densité.
KODAK indique une tolérance de 5% sur la densité des filtres WRATTEN 96 et notre dispositif d'illumination des films provoque une erreur inférieure à 2,5% sur le rapport des durées des deux expositions. Il faut donc compter une erreur totale de 7,5% (au moins) sur ce rapport pour interpréter les résultats (incertitude de 0,03 sur le logarithme de la lumination).
D'autre part, il faut que les conditions de développement soient bien déterminées. Nous développons toujours nos films dans un révélateur neuf à 20°C et avec une durée soigneusement contrôlée (que ce soit pour un test sensitométrique ou pour un autre motif).
Cette méthode n'est pas exempte de défauts, mais elle convient très bien pour comparer des résultats obtenus dans différentes conditions sur un même film. Remarquez qu'il n'est pas sérieux de comparer en détail, avec cette méthode, la sensibilité et le contraste de deux films différents. En effet, le spectre de la source lumineuse est très limité et nous négligeons complètement la diffusion de la lumière à l'intérieur de l'émulsion (ce qui perturbe sensiblement les mesures de densité et de contraste).
L'hypersensibilisation au forming gas.
Nous allons décrire une installation économique d'hypersensibilisation gazeuse pour astronome amateur. Cette solution a fait ses preuves et peut être réalisée par n'importe quel bricoleur.
Le gaz
De nombreux gaz sont envisageables pour hypersensibiliser une émulsion photographique. Cependant il y en a un qui est presque universellement adopté par les amateurs et les professionnels. Il s'agit du forming gas, c'est un mélange d'hydrogène et d'azote dont les proportions diffèrent selon les auteurs. Nous utilisons un mélange qui contient 92% d'azote et 8% d'hydrogène. Nous nous le procurons auprès des établissements AIR PRODUCTS :
AIR PRODUCTS
78 rue CHAMPIONNET
75881 PARIS Cedex 18
Tel. : 0800 480 000
Vous devez demander un mélange "qualité U" contenant 92% d'azote et 8% d'hydrogène. Il est répertorié chez AIR PRODUCTS sous la dénomination PROTEC 8. Bien entendu, vous pouvez contacter d'autres fournisseurs.
Du point de vue financier, il faut s'attendre à payer la charge de gaz (451 F TTC) et la location d'une bouteille. Sur ce point, nous avons opté pour une location de 5 ans (340F TTC par an). L'emballage standard est une lourde bouteille métallique d'environ 1,70 mètre de haut. Cela pourra vous poser quelques difficultés pour le transport mais vous pourrez la faire livrer. Le contenu de cette bouteille dure plusieurs années. Il n'est pas idiot de prendre un emballage plus petit, mais il n'est guère moins cher.
Vous devrez tout d'abord passer une commande téléphonique à votre dépositaire pour qu'il approvisionne votre bouteille. En effet, le forming gas est rarement disponible. Prévoyez un délai de deux à quatre semaines.
La température
Notre première installation traitait les films à la température de 30°C. La régulation de la température était réalisée simplement et l'isolation était sommaire. Les résultats étaient excellents mais le traitement durait deux semaines. Ensuite nous sommes passés au traitement à 40°C, qui demandait plusieurs jours.
Aujourd'hui notre installation fonctionne à 50°C. Les résultats sont équivalents mais le TP2415 peut être hypersensibilisé en 24 heures seulement. Il a fallu prévoir un chauffage plus intense de la cuve et une très bonne isolation thermique de celle-ci pour obtenir une bonne uniformité de sa température.
La cuve
Il s'agit de la cuve dans laquelle séjournent les films pendant le traitement d'hypersensibilisation. Elle doit être robuste, hermétique et doit pouvoir contenir un gaz avec une pression de un Bar.
Certains font usiner à grand frais un récipient en acier inoxydable. Nous avons choisi d'utiliser un autocuiseur en acier inoxydable (cocotte-minute). C'est la solution la plus utilisée dans les observatoires amateurs et professionnels.
Notre cuve peut contenir jusqu'à neuf films au format 135 (24x36) enroulés sur des spires de développement. Rien n'interdit de prendre un modèle de capacité différente.
La purge
Avant de commencer le traitement, il faut purger la cuve qui contient les
films de tout l'air qu'elle renferme. En fait, il faut surtout éliminer
l'oxygène et la vapeur d'eau. Pour cela nous vous proposons les
deux méthodes différentes que nous avons utilisées.
Elles ont donné toutes deux d'excellents résultats.
La Purge au forming gas :
L'air est constitué approximativement
de 80% d'azote, de 20% d'oxygène et quelques traces d'autres gaz
(dont la vapeur d'eau).
Supposons que dans notre cuve étanche remplie d'air nous ajoutons du forming gas jusqu'à doubler la pression. Ouvrons un robinet qui fait communiquer l'enceinte avec l'extérieur pour ramener la pression à une valeur voisine de celle de l'atmosphère et refermons-le. A ce moment nous avons à l'intérieur de la cuve une pression relative nulle et un mélange de 50% d'air et de 50% de forming gas. Il n'y a donc plus que 10% d'oxygène. Nous avons diminué de moitié la quantité d'oxygène contenue par la cuve.
Si nous renouvelons cette manipulation, nous obtiendrons un mélange ne contenant plus que 5% d'oxygène. Et ainsi de suite, la proportion de ce gaz diminue de moitié chaque fois que nous recommençons. Après huit ou dix répétitions nous aurons à l'intérieur de la cuve un forming gas presque pur, il n'y aura plus que quelques traces d'oxygène.
Cette technique nécessite un gaspillage important de forming gas et elle est fastidieuse mais elle est simple et efficace.
Attention ! Au début de cette manœuvre, l'air et le forming gas sont mélangés à parts égales dans la cuve étanche. Ce mélange peut être détonnant, il faut donc s'assurer que l'installation électrique soit débranchée afin qu'aucune étincelle ne puisse se produire dans l'autocuiseur.
La pompe à vide : La technique la plus évidente pour chasser l'oxygène de la cuve est de faire le vide à l'intérieur, mais une pompe à vide coûte très cher.
Un de nos amis qui est frigoriste de métier nous a indiqué une solution économique : un compresseur de réfrigérateur. Prenez un vieux réfrigérateur et observez-le par-derrière. Vous verrez en bas une cuve aux formes arrondies à laquelle aboutissent deux tuyaux et un fil électrique. Cet objet contient un compresseur qui peut être utilisé comme pompe à vide.
Sortez donc ce compresseur de l'ustensile ménager qui l'abrite et coupez les fils et les tuyaux qui le lient au circuit de refroidissement. Ceci doit être fait à l'extérieur, au grand air, de façon à éviter les émanations gazeuses toxiques dues à l'évaporation du liquide de refroidissement. Ensuite aménagez un branchement électrique avec un interrupteur de mise en route.
Vous êtes maintenant en possession d'une pompe à vide avec laquelle vous purgerez efficacement votre cuve d'hypersensibilisation. Notre montage comporte un tel compresseur de réfrigérateur. Pour la description qui va suivre c'est cette solution que nous retiendrons.
La durée du traitement
La durée du traitement dépend surtout du résultat souhaité. Il vous faudra faire différents essais. Après avoir effectué les tests sensitométriques, vous déciderez de la durée qui vous donne le meilleur compromis entre la sensibilité obtenue, le voile et la conservation du film.
C'est surtout le voile de l'émulsion qui sera redouté. Il s'agit de la densité du film dans les parties non exposées. A partir d'une certaine durée, différente pour chaque émulsion, le traitement accentue le voile sans améliorer la sensibilité.
Conditions d'hypersensibilisation du TP2415
Habituellement, nous traitons ce film pendant 48heures à 50°C sous une pression relative de 1 Bar. Cette dernière influe sur la qualité du résultat et elle permet de vérifier l'étanchéité de la cuve. De plus la cuve n'est jamais parfaitement étanche, cette pression empêche donc à l'air de pénétrer dans la cuve.
Nous conservons les films ainsi traités dans une boîte métallique que nous plaçons dans un congélateur (à -30°C).
Hypersensibilisation des films couleurs
Peu de gens s'expriment avec précision sur l'hypersensibilisation des films couleurs. Nous voyons deux raisons principales à ce fait.
Un film couleur comporte trois couches d'émulsions photographiques, chacune est sensible à un domaine du spectre visible. Ces trois couches ont des propriétés différentes et ne réagissent pas de la même façon à l'hypersensibilisation. Il n'est donc pas possible de modifier la sensibilité du film d'une même quantité pour toutes les couleurs. La conséquence est une dégradation de l'équilibre chromatique du film. Notez que ce déséquilibre évolue selon la durée de la pose.
La deuxième raison se trouve dans les fluctuations importantes des propriétés des émulsions couleurs. Les fabricants s'engagent sur des caractéristiques concernant la photographie usuelle (sensibilité ISO, contraste, équilibre chromatique pour les poses courtes, ...), mais pas sur les caractéristiques qui nous intéressent ici. C'est pour cela que les résultats d'expériences sur l'hypersensibilisation de films couleurs évoluent dans de très grandes proportions en l'espace de deux ou trois mois seulement. Nous n'avons jamais constaté de telles variations pour le TP2415.
Il y a bien entendu d'autres raisons car les films couleurs ne sont pas adaptés à l'astrophotographie des objets faibles. En effet, leur contraste et leur sensibilité sont trop faibles, leur granulation est importante, ... Ne parlons pas des difficultés à faire les mesures ...
Nous avons fait de nombreux essais sur les films couleurs. Il ne serait pas utile de les exposer ici à cause des variations que nous venons de citer. De toute façon le résultat est beaucoup moins spectaculaire que celui du TP2415.
Dans le domaine de la photographie astronomique en couleur, les meilleurs résultats sont obtenus avec la technique utilisant le compositage couleur de clichés noir et blanc pris dans des couleurs rouge, vert et bleu. Cette technique permet d'obtenir des clichés réellement utiles et interprétables, alors que les films couleurs donnent des photographies esthétiques mais très pauvres en informations.
Réalisation d'un dispositif d'hypersensibilisation au forming gas
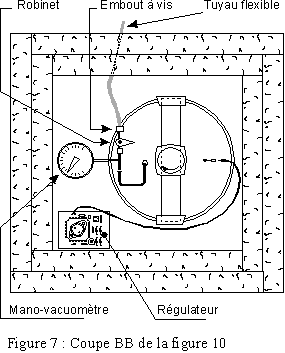
C'est un autocuiseur neuf en acier inoxydable de marque SEB de 6 litres de contenance qui fait office de cuve. Nous l'avons disposé à l'intérieur d'une enceinte thermostatée. Il semble souhaitable, d'après certains, de ne pas utiliser un modèle en aluminium car il serait moins hermétique pour l'hydrogène. Notre première installation comportait un vieil autocuiseur en aluminium. Il résistait mal à la pression nécessaire et nous avons du le renforcer. Notez qu'il nous a donnés de bons résultats mais nous lui préférons le modèle en inox.
Nous avons mastiqué tous les interstices pouvant permettre une fuite (rivets, soupape, vis, ...) avec une colle époxy (genre ARALDITE). Puis nous avons installé un système électronique de régulation de la température et un dispositif d'alimentation en gaz selon la figure 7. Il s'agit d'un tube de cuivre soudé à l'étain sur le corps de la soupape après avoir débarrassé celle-ci de sa valve. A l'autre extrémité de ce tuyau nous avons installé un mano-vacuomètre et un robinet à gaz. Ces deux accessoires sont fixés sur un raccord en T. Notez la forme du tuyau, il est coudé en trois endroits. Ainsi, il fait office de chicane à lumière et empêche celle-ci de pénétrer dans la cuve quand le robinet est ouvert.
Attention ! Nous avons détérioré la soupape de l'autocuiseur. Ceci peut entraîner de graves problèmes de sécurité sur l'installation. Il faut impérativement limiter la pression relative du gaz à l'intérieur de la cuve à 1 Bar. Une pression supérieure peut entraîner une explosion de la cocotte. Nous décrivons ici notre installation mais chacun doit prendre ses dispositions en fonction de son équipement afin de s'assurer que la pression ne puisse devenir excessive.
Le robinet à gaz est un modèle standard destiné aux installations domestiques de gaz de ville. Nous l'avons équipé d'un embout à vis sur lequel vient se fixer le tuyau souple qui conduit le forming gas.
Il est indispensable de contrôler l'étanchéité de cet ensemble. Il suffit de mettre la cuve sous pression (1 bar relatif) avant de la plonger dans l'eau. Toute fuite sensible émet un chapelet de bulles d'air. En 24 heures elle ne doit pas perdre plus du dixième de sa surpression de gaz. Autrement dit, si nous mettons une surpression de un Bar dans la cuve, nous devrons retrouver au moins 0,9 Bar le lendemain.
Le mano-vacuomètre
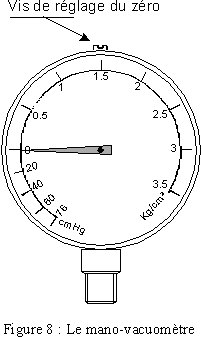
Cet appareil que vous pouvez voir sur la figure 8 est employé dans les installations frigorifiques. C'est un manomètre capable d'indiquer aussi bien la pression que le vide. Il comporte habituellement plusieurs échelles graduées avec différentes unités. Lorsqu'il est bien réglé le mano-vacuomètre indique zéro si on ne lui applique aucune pression. Les valeurs de pressions que nous indiquerons plus loin sont toutes en Bar.
1 Bar = 1 Atmosphère (environ)
1 Bar = 76 centimètres de mercure = 76 cm Hg
Disposition des films dans la cuve
Les films à traiter doivent être enroulés dans des spires de développement afin que le gaz puisse circuler librement sur l'émulsion. Ils ne doivent en aucun cas être laissés dans leur cartouche. Notre cuve peut contenir jusqu'à neuf pellicules ainsi conditionnées (format 135).
Pression relative et absolue
La pression peut être indiquée en valeur absolue ou relative à la pression atmosphérique. Quand le robinet de la cuve est ouvert, l'intérieur de celle-ci est en contact avec la pression atmosphérique. La pression relative est donc nulle mais sa pression absolue est une atmosphère (environ 1 Bar). Exemple : Si la surpression à l'intérieur de la cuve est 1 Bar, la pression relative est 1 Bar et la pression absolue est 2 Bars.
Le mano-vacuomètre donne des indications de pression relatives. L'échelle du vide est habituellement graduée en cm de mercure (cm Hg). Le vide correspond à -76 cm Hg.
Nous spécifierons toujours le type de pression auquel nous faisons allusion.
Le régulateur de température
Un dispositif électronique simple, comme celui de la figure 9, permet une très bonne régulation de la température. Il ne possède pas de condensateur de filtrage car celui-ci supporterait mal la température de 50°C.

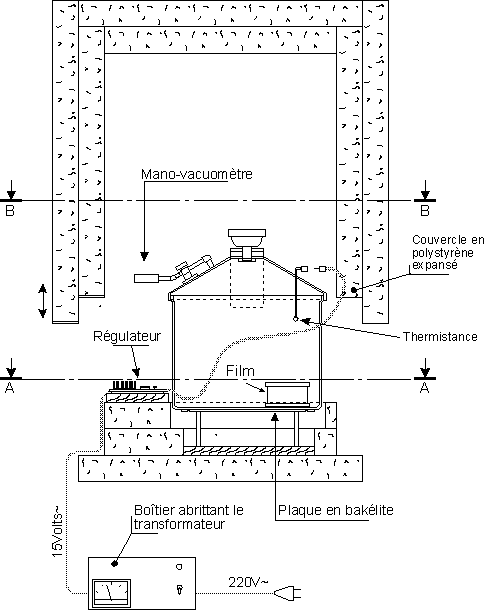
Notre thermistance (ou résistance CTN) a une valeur de 1K à 25°C, à 50°C sa résistance est de 400 Ohms. Sa valeur peut être différente. Dans ce cas il faut changer aussi R1. Celle-ci est proportionnelle à la valeur de la thermistance.
Exemple : si Th a une valeur de 1200 Ohms à 50°C, il faut choisir pour R1 une valeur de 100K.
Nous avons soudé ce capteur de température à deux fils de 10cm de long. Ceux ci passent à l'intérieur du tube qui traverse le couvercle de l'autocuiseur et qui est destiné à recevoir le sifflet tournant. Nous les avons soudés à un connecteur CINCH sur le bout extérieur du tube. Nous avons noyé la thermistance et ses soudures dans une gangue de colle époxy pour les isoler électriquement. Il faut aussi mastiquer l'extrémité des fils car sinon le gaz s'infiltre entre le conducteur et l'isolant et s'enfuit... De plus, Nous avons colmaté avec un mastic opaque (ou bien avec de l'ARALDITE teinte en noir) le passage des fils dans le tuyau. Ainsi la thermistance est pendue dans la cuve et celle-ci peut être déconnectée du circuit électronique.
Avant le premier essai, vérifiez tout d'abord vos soudures, ensuite contrôlez l'orientation des composants. Pour régler ce dispositif, nous plongeons la thermistance dans un verre d'eau à 50°C. Il ne reste plus qu'à agir sur le potentiomètre ajustable. Nous l'amenons en butée en le tournant de sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite nous le tournons lentement dans l'autre sens jusqu'à ce que l'aiguille de l'ampèremètre dévie rapidement. Ce réglage doit être amélioré lorsque le système d'hypersensibilisation est terminé en mesurant la température de la cuve. En effet, à ce moment le circuit imprimé sera lui aussi à 50°C, et ceci influence nettement le réglage.
Le transformateur d'alimentation est placé dans un boîtier à l'extérieur de l'enceinte avec un ampèremètre (modèle 3 Ampères) qui est connecté en série avec le circuit électronique. Cet accessoire de mesure n'est pas indispensable mais il permet de constater le bon fonctionnement de la régulation. Avec cette disposition la tension du secteur ne peut jamais être en contact avec le métal de la cuve.
Vous trouverez les composants auprès des distributeurs de composants. Pour des achats par correspondance vous pouvez éventuellement contacter la société CONRAD.
Le dessin de ce circuit le représente vu depuis le côté composants.
Les résistances
Le chauffage est assuré par 30 résistances de 220 Ohms /2Watts disposées en parallèle. Elles sont réparties sur quatre petits panneaux de bakélite cuivrée disposés autour de la cuve. Une saignée dans le cuivre sépare deux pistes sur lesquelles sont soudées les résistances. Deux panneaux portent sept résistances, ils sont placés à l'opposé du circuit électronique. Les deux autres portent seulement six résistances. Cette disposition légèrement asymétrique permet de compenser la présence du régulateur qui chauffe l'enceinte lui aussi. Quatre autres résistances identiques sont placées sous le support de l'autocuiseur.
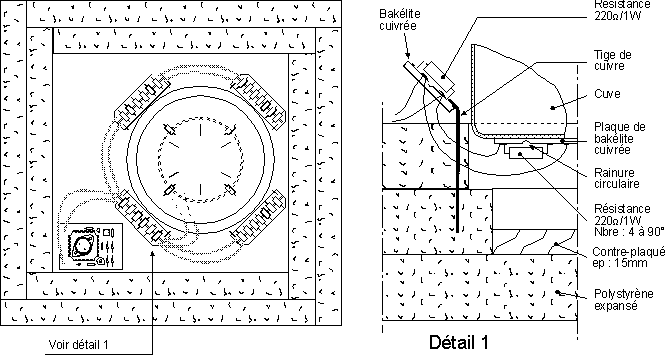
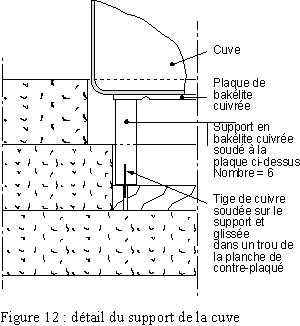
Cette configuration nous permet d'obtenir une température très homogène dans la cuve. Les plus grandes différences de températures moyennes que nous avons mesurées, entre différents points de la cocotte, sont inférieures à 0,3°C.
L'isolation thermique de la cuve
La température de la cuve doit être constante et uniforme. Pour cela nous l'isolons pendant le traitement en la plaçant dans une boîte en polystyrène expansé dont les parois ont 8cm d'épaisseur. Vous pouvez vous procurer ce matériau sous forme de plaques auprès des grandes surfaces du bricolage ou des marchands de matériaux de construction. Pour confectionner notre enceinte thermostatée, nous avons employé des doubles épaisseurs de plaques de 4cm (figures 10, 11 et 12).
Il existe des colles spéciales pour le polystyrène expansé, n'utilisez pas d'autres produits. Vous pouvez couper ce matériau avec une scie, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats avec un fil chaud.
Les accessoires de la bouteille de gaz
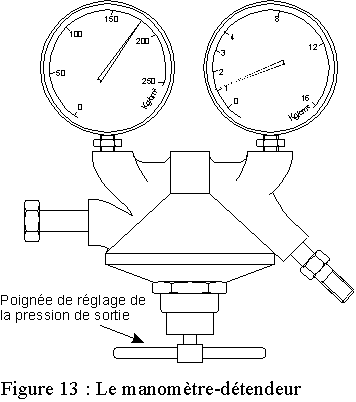
La bouteille de forming gas est fournie sans la clef qui permet de manipuler la vanne de fermeture. Il vous faut donc l'équiper avec un tel accessoire.
Lorsque la bouteille vous est livrée, il règne à l'intérieur de celle-ci une pression de 200 Bars qui est bien trop élevée pour notre montage. Pour domestiquer cette pression il existe un appareil, le manomètre-détendeur, qui se fixe à la sortie de la bouteille. Prenez garde à ce que la fixation du manomètre-détendeur soit compatible avec votre bouteille de forming gas (filetage à gauche).
Ce manomètre-détendeur fournit en sortie une pression dont la valeur maximum est réglable entre zéro et quelques Bars (Figure 13). D'autre part il affiche la pression du gaz dans la bouteille ainsi que la pression à la sortie. Vous pourrez probablement vous procurer cet accessoire auprès de votre fournisseur de forming gas, on peut en trouver à partir de 300 Francs environ.
Le compresseur de réfrigérateur
Nous avons testé plusieurs compresseurs de réfrigérateur en mesurant "le vide" qu'ils produisent. La plupart de ceux-ci descendent jusqu'à 30 ou 40mm de mercure. Le meilleur allait jusqu'à 20mm et le plus mauvais 250mm de mercure. Il faut donc tester votre compresseur de réfrigérateur avant de le déclarer bon pour le service.
Nous ignorons quelle est la teneur maximale en oxygène tolérable dans la cuve lors du traitement. Cependant, nous avons fait un essai d'hypersensibilisation avec 1,3% d'oxygène dans le forming gas. Nous avons obtenu cette valeur en arrêtant la purge à 100mm de mercure. Les tests sensitométriques (voir plus loin) n'ont pas montré de différence de sensibilité avec un film traité avec un résidu d'oxygène inférieur à 0,13% (purge jusqu'à moins de 10mm de mercure), mais le voile s'est accru.
D'autres essais semblent montrer que la pression résiduelle d'air doit être inférieure à 40mm de mercure pour être sans conséquence (soit 0,5% d'oxygène dans le forming gas, avec P(relative) = 1Bar).
Pression et température
La pression à l'intérieur de la cuve, lors du traitement, doit être correctement déterminée pour obtenir des résultats reproductibles.
La physique nous enseigne que dans notre cuve, une fois le remplissage effectué, la pression du gaz évolue proportionnellement à la température absolue. Autrement dit, si nous faisons le remplissage de forming gas jusqu'à 1 Bar de pression relative à une température ambiante de 20°C, la pression augmentera avec la température et sera de 1,2 Bar à 50°C. Dans ce cas, la température absolue et la pression absolue ont toutes deux augmentées de 10%.
Par ailleurs les indications du mano-vacuomètre varient avec sa température.
En conclusion, ne vous fiez au mano-vacuomètre que s'il est à la température pour laquelle vous lui avez réglé le zéro et prévoyez que la pression évolue avec la température. Nous-mêmes faisons le remplissage à température ambiante et nous l'arrêtons à 0,8 Bar (pour un traitement à une pression relative de 1 Bar à 50°C).
Le dispositif d'hypersensibilisation dans son ensemble
La figure 14 montre notre installation d'hypersensibilisation au forming gas à 50°C. Elle illustre la connexion des différents éléments que nous avons étudiés précédemment.
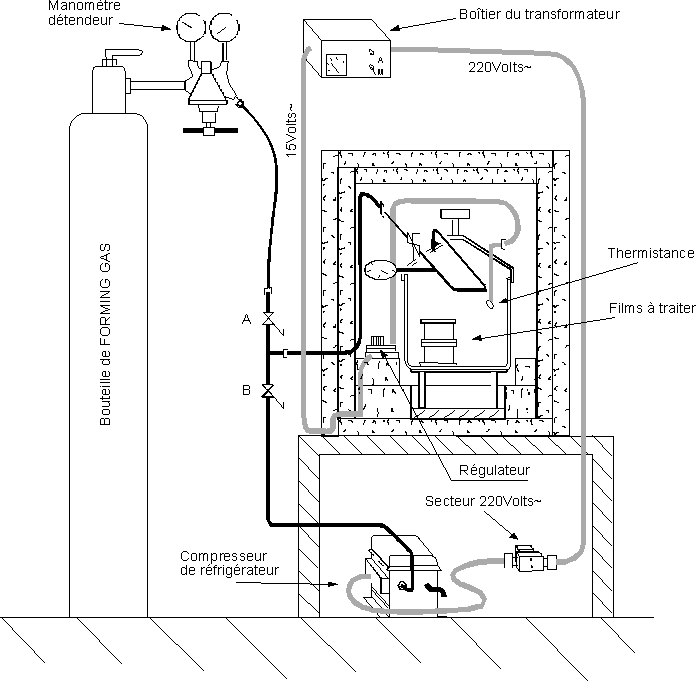
Notez aussi la présence des deux robinets A et B qui permettent de diriger le flux de gaz. Comme le robinet de la cuve, ce sont des modèles standard destinés aux installations domestiques de gaz de ville. Ils sont reliés à un raccord en T. Un tuyau souple est fixé sur la troisième branche de ce raccord. L'autre extrémité de ce tuyau est visée sur l'embout à vis de la cuve lors du remplissage. Pendant le traitement, il est détaché.
Notre système fonctionne ainsi depuis 1986.
Conservation des films hypersensibilisés
Les films hypersensibilisés doivent être conservés au froid à l'abri de la lumière et de l'humidité.
On peut conserver les films hypersensibilisés au réfrigérateur, mais le congélateur permet une meilleure conservation.
Les boîtes en matière plastique qui sont fournies avec certains films peuvent être utilisées pour protéger les films traités contre l'humidité ou la condensation qui pourrait se produire à la sortie du congélateur. Cependant, il ne faut pas croire que ces boîtes sont suffisamment opaques. En effet, les films hypersensibilisés peuvent être voilés par la lumière qui réussit à pénétrer dans leur cartouche. N'oubliez pas que leur défaut de réciprocité est plus faible. Ils doivent être conservés dans une obscurité totale.
Nous conservons nos films hypersensibilisés au congélateur dans des boîtes métalliques ou enroulés dans une feuille d'aluminium. Ils sont encore utilisables après plusieurs mois (voir exemple plus loin).
Le forming gas est inodore et n'est ni explosif ni dangereux à respirer. Encore faut-il qu'il reste un minimum d'oxygène dans l'air. Par conséquent, sur ce point il n'est pas nécessaire de prendre des précautions particulières, assurez une aération normale au local.
Le compresseur de réfrigérateur est silencieux, donc on oublie souvent de l'arrêter. Pensez-y.
Ne serrez pas trop fort la vanne de la bouteille, elle peut casser.
Conduite d'une hypersensibilisation
Préparation
Il faut tout d'abord s'assurer que la pression du gaz ne peut pas s'élever à plus de 1,1 Bar en sortie du manomètre détendeur. Le cas échéant il faut agir sur la vis de réglage. Si la pression devenait trop forte au cours du traitement, la cocotte ne pourrait pas retenir le gaz et le soulèvement du couvercle permettrait à la lumière d'entrer.
Dans l'obscurité
Dans une pièce obscure, montez les films à traiter sur des spires de développement que vous placerez ensuite dans la cuve. Refermez la cuve en serrant très fort la poignée.
A la lumière
Ouvrez le robinet de la bouteille et le robinet A. Laissez ainsi partir un peu de forming gas pour purger l'air contenu dans la tuyauterie. Refermez le robinet A et fixez le tuyau souple à la cuve. Ouvrez le robinet de la cuve.
Ouvrez le robinet B et mettez en route la pompe à vide. Dès que le mano-vacuomètre indique un bon vide (-760mm de mercure), il faut environ deux minutes pour cela, refermez le robinet B et arrêtez la pompe.
Ouvrez ensuite le robinet A jusqu'à ce que le mano-vacuomètre indique 1 Bar (ou 15 PSI). A ce moment il faut refermer le robinet A, refermer le robinet de la bouteille, refermer le robinet de la cuve et débrancher le tuyau.
Placez le couvercle isolant en polystyrène expansé sur la cuve et mettez en marche le dispositif de chauffage.
Voilà, le traitement est commencé, vérifiez toujours avant de partir que la bouteille est fermée et que la pompe est arrêtée.
Fin du traitement
Lorsque le traitement est terminé, sortez les films (dans l'obscurité!) et enroulez-les dans leurs cartouches.
N'oubliez pas d'arrêter le chauffage.
Les films peuvent être conservés plusieurs mois au réfrigérateur dans des emballages étanches. Pour éviter tout problème de condensation, il faut laisser les films se réchauffer à la température ambiante avant de les sortir de cet emballage. N'oubliez pas que les cartouches des films ne sont pas assez étanches à la lumière, il faut les conserver dans des boîtes opaques.
Résultats
Dans ce chapitre nous allons étudier les résultats de tests sensitométriques que nous avons effectués sur différents films hypersensibilisés ou pas.
Tous les traitements d'hypersensibilisation évoqués ci-après ont été réalisés avec une pression relative de 1 Bar.
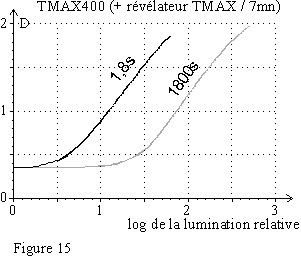
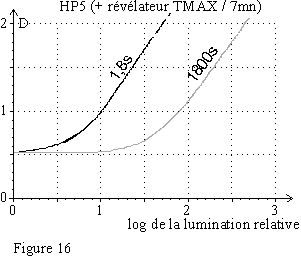
Les figures 15 et 16 nous rappellent quelques caractéristiques du TMAX400 et du HP5. Ces deux résultats sont semblables. Ces films ont un contraste "normal" c'est à dire trop faible pour la photographie des nébuleuses et galaxies. Nous constatons aussi un voile sensible et un défaut de réciprocité important.
Nous pouvons améliorer le contraste du TMAX400 en utilisant le révélateur D19, c'est ce que montre la figure 17.
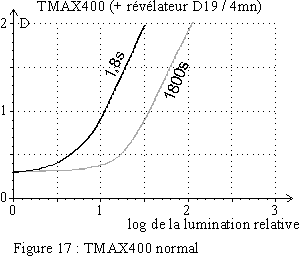
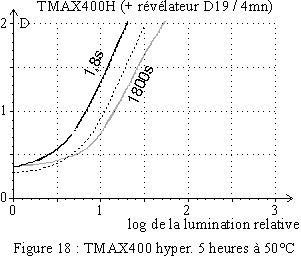
La figure 18 illustre l'atténuation du défaut de réciprocité du TMAX400 par une hypersensibilisation au forming gas pendant 5 heures à 50°C. La courbe en pointillé rappelle les caractéristiques de la figure 17 (TMAX400 + D19 pendant 4mn, pose de 1,8 seconde). Nous constatons que le défaut de réciprocité pour les poses inférieures à une demi-heure a nettement diminué mais aussi que la sensibilité aux courtes expositions s'est accrue.
Ce traitement a augmenté de 2,5 fois la sensibilité du TMAX400 pour les poses de une demi-heure et de 1,5 fois pour les poses courtes.
Nous notons aussi que le voile de l'émulsion s'est accentué.
Les films spectroscopiques de la série 103a
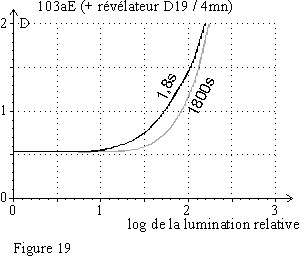
Ces films sont destinés aux longues expositions. Ils ont un faible défaut de réciprocité sans nécessiter d'hypersensibilisation. Vous pouvez voir ci-contre le résultat d'un test sur le 103aE. Notez le voile important et la forme arrondie de la courbe, elle n'a pas vraiment de partie linéaire. Les films 103aF et 103aO ont des propriétés sensitométriques semblables à celles-ci à l'exception de la sensibilité spectrale.
Ces émulsions étaient très appréciées par les astronomes amateurs et professionnels avant l'arrivée du TP2415. Ils ont une granulation très importante. Aujourd'hui ils ne sont pratiquement plus utilisés.
La figure 20 nous indique les courbes sensitométriques du TP2415 normal. Il a un faible voile, sa courbe est bien formée (comparer au 103aE), il a un fort contraste et un défaut de réciprocité très important. Pour les poses de 1800 secondes sa sensibilité est plus de 6 fois plus faible que pour les courtes expositions.
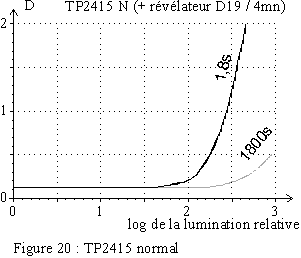
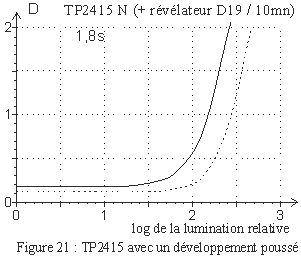
Nous avons reporté en pointillés la courbe de la figure 20 relative aux poses de 1,8s sur la figure 21. Cette dernière nous montre que la sensibilité est presque doublée quand nous prolongeons le développement dans le D19 jusqu'à 10 minutes. En contrepartie, le voile a augmenté et la qualité de l'image est dégradée. En effet, le meilleur rapport signal sur bruit du TP 2415 développé avec le D19 est obtenu avec un séjour de 4 minutes dans ce révélateur.
L'hypersensibilisation standard du TP2415
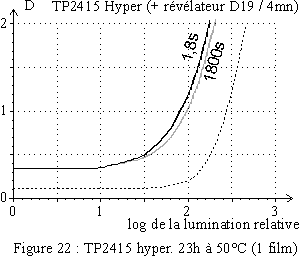
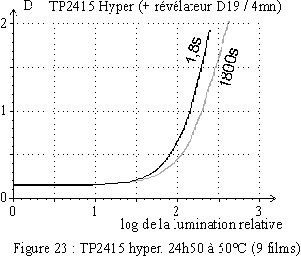
La figure 22 nous révèle comment un séjour de 23 heures dans le forming gas à 50°C transforme ces caractéristiques. Sur cette illustration, nous indiquons en pointillés la courbe caractéristique de ce film sans traitement pour les poses de 1,8 seconde.
Après ce traitement le défaut de réciprocité est très réduit. Le film est 3 fois plus sensible pour les courtes poses et 25 fois pour les expositions de 1800 secondes. Nous ne sommes pas certains que le défaut de réciprocité résiduel soit réel, il peut être provoqué par les différentes incertitudes de notre méthode de sensitométrie (incertitude sur la densité du filtre, sur le temps de pose, ...). Notez aussi l'accroissement du voile qui serait encore aggravé par un traitement plus long sans amélioration notable de la sensibilité.
La figure 22 illustre le résultat d'une hypersensibilisation avec notre système dans lequel nous avons fait séjourner un seul film (au format 135) d'une longueur de 1m (20 poses + bande amorce).
La figure 23 nous montre le résultat d'un traitement semblable avec 9 films de la même longueur. L'hypersensibilisation est nettement moins efficace car le défaut de réciprocité est encore sensible.
Pour obtenir un résultat équivalent à celui de la figure 22 avec 9 films, il est nécessaire de doubler la durée du séjour dans le forming gas. La figure 24 expose le résultat d'un traitement de 9 films (de 1,25m) pendant près de 48 heures. Le défaut de réciprocité et le voile sont faibles.
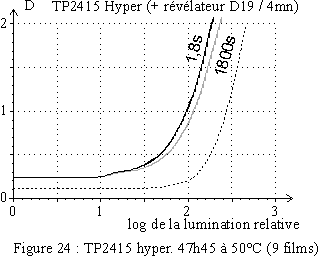
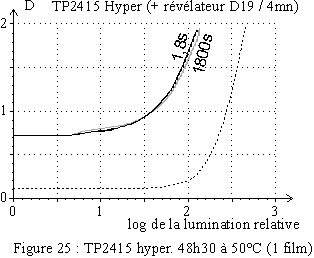
De plus, la figure 25 démontre qu'un séjour de 48 heures dans notre cuve serait trop long pour un seul film de 1,25m. En effet, dans ce cas il n'y a pas d'amélioration de la sensibilité et le voile devient excessif (les courbes sont uniquement décalées vers le haut par le voile).
Il est donc évident que la durée idéale du traitement dépend du nombre de films traités. Dans notre cas, nous devons traiter un film unique dans le forming gas pendant environ 22 heures. Cette durée se prolonge jusqu'à 48 heures lorsque nous voulons hypersensibiliser 9 films en même temps. Notez que ces temps de traitement varient d'une installation d'hypersensibilisation à l'autre.
Nos tests nous ont permis de constater que, lors de l'hypersensibilisation, le voile de l'émulsion se met à augmenter quand la sensibilité a atteint son maximum (pour les poses de une demi-heure). La densité du voile de l'émulsion est donc un bon indicateur de la qualité du traitement, elle ne doit pas dépasser 0,5. Bien entendu, cette dernière remarque est valable uniquement s'il n'y a pas d'autre cause à la présence du voile.
Reproductibilité des résultats
Nous avons vu que l'effet d'un traitement d'hypersensibilisation dépend du nombre de films traités. Il est aussi fonction de la pression du forming gas dans la cuve et de la température du traitement. Certains remplacent le forming gas pendant le traitement, le nombre de ces purges influence aussi le résultat.
C'est pour cela qu'il faut toujours conserver les mêmes conditions de traitement et adapter la durée en conséquence. Après le renouvellement de la bouteille de forming gas, il faut remettre en question cette durée.
Ainsi, nous obtenons des résultats très fiables et très constants si nous reproduisons fidèlement les caractéristiques du traitement.
Conservation du TP2415 hypersensibilisé
Sur les figures 26 et 27 nous avons tracé en pointillé la courbe de la figure 24 pour les poses de 1,8 seconde. Sur la première, nous avons inscrit les graphes obtenus avec la même émulsion conservée 4 jours à la température ambiante.
La principale conséquence est une légère montée du voile. Si cette conservation se prolonge le voile s'intensifie et devient intolérable.
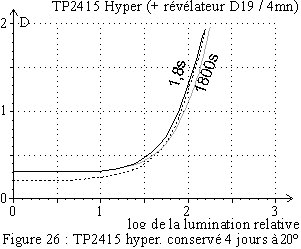
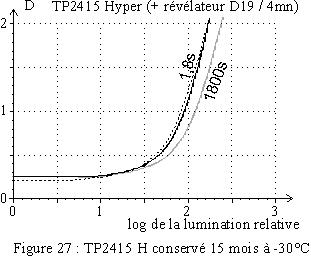
Sur la figure 27 nous constatons le résultat après 15 mois de conservation dans un congélateur. Ceci justifie notre préférence pour cette méthode.
Sécurité de l'installation
Sur cette installation, nous utilisons des techniques qui peuvent nous mettre dans des situations dangereuses.
La pression ne doit pas atteindre des valeurs excessives dans la cuve. En effet, les autocuiseurs ne sont pas conçus pour supporter des pressions relatives supérieures à un Bar. Il faut donc s'assurer que le manomètre détendeur est réglé pour limiter la pression de sortie à 1,1 Bar au maximum. Au moment du remplissage, il faut être très attentif à la pression afin qu'elle ne devienne pas trop forte. Pendant cette phase, il faut toujours imaginer que le manomètre détendeur peut tomber en panne...
Une autre préoccupation concerne les propriétés que pourraient avoir le mélange d'air et de forming gas. Celui-ci peut être détonnant ou inflammable si la concentration d'hydrogène devient égale ou supérieure à 4%. Il faut donc aérer convenablement le local de travail et s'assurer de l'absence totale de flammes ou d'étincelles.
Bibliographie
L'ANSTJ a publié un fascicule "infos Astro N°14" qui expose
de façon claire tout ce qu'un astronome amateur doit savoir sur
l'astrophotographie et sur l'hypersensibilisation. Renseignez-vous auprès
de :
Association Nationale Sciences
et Techniques Jeunesse
Commission des clubs d'astronomie
17 Avenue Gambetta
91130 RIS-ORANGIS
Tel : 01 69 06 82 20
Jean Louis HEUDIER nous a appris presque tout ce que nous savons sur l'hypersensibilisation. Cet astronome de l'observatoire de la Côte d'Azur a écrit un ouvrage qui évoque de nombreux aspects de la photographie astronomique et de l'hypersensibilisation. Il s'agit du livre "Photographie astronomique à grand champ" édité par Masson.
Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être conseillés par David MALIN. Ce photographe de recherche de l'observatoire anglo-australien de Nouvelle Galles du Sud est l'auteur d'un grand nombre de clichés spectaculaires et il a publié plusieurs ouvrages sur la photographie astronomique. En langue française, vous pouvez notamment lire "Couleur des étoiles" édité par Masson
Conclusion
Cette réalisation est à la portée de la plupart des astronomes amateurs ou des clubs et n'exige pas d'investissement important. Grâce à cette technique nous avons réussi des clichés dont la qualité était inaccessible avec des films de la série 103.
Sur le site ASTROPHOTOGRAPHIE AMATEUR EN PROVENCE, Jean-Pierre BOUSQUET, un membre de l'Association Marseillaise d'AStronomie, nous expose de magnifiques clichés réalisés avec des films hypersensibilisés.
Le 22 septembre 2004, KODAK a annoncé la fin de la production du TP2415...



