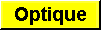NOTIONS D'OPTIQUE
POUR LES ASTRONOMES AMATEURS
La vision
La vision est un phénomène merveilleux et complexe, son étude concerne un vaste ensemble de disciplines indépendantes (optique, physiologie, neurologie, psychologie, etc.). Nous nous contenterons d'un aperçu sur les notions de base et sur les connaissances utiles pour apprécier au mieux les images astronomiques.
Description de l'il
L'il est l'organe de la vision. Observons les figures 1 et 2. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent, l'humeur vitrée. La lumière pénètre dans l'il par un orifice circulaire situé au centre de l'iris, la pupille.
Le cristallin constitue avec la cornée et l'humeur aqueuse un objectif qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'il. La rétine tapisse le fond de l'il. Elle est le capteur des informations visuelles qu'elle convertit en message nerveux destiné au cerveau.
La surface utile de cet objectif est la pupille dont le diamètre varie en fonction de la luminosité ambiante. En effet, l'iris animé par un mouvement réflexe dilate ou rétracte son orifice central pour réguler le flux lumineux entrant dans l'il.
Le cristallin est plus qu'une simple lentille. En effet il se déforme pour adapter sa puissance dioptrique à la distance de l'objet. Il fournit ainsi une image nette. C'est l'accommodation de l'il.
Notre cerveau analyse les images fournies par l'il et dirige en permanence l'accommodation du cristallin. Ce processus est inconscient.
Un il normal est dit emmétrope. Sans accommodation (au repos), il perçoit une image nette d'un point éloigné à l'infini. Ce point, le plus éloigné pour une vision nette, est appelé punctum remotum. Le point le plus proche qui puisse être vu nettement est le punctum proximum. Pour un jeune adulte, il est habituellement à une vingtaine de centimètres de l'il.
En observant à travers l'oculaire d'un instrument d'optique, l'il accommode à une courte distance d'environ 30 à 50 centimètres, il n'est pas au repos. Cette distance accommodation est variable selon les individus. Il est donc normal que deux personnes qui ont toutes deux une bonne vue fassent un réglage de mise au point différent.
Le cristallin est un organe fragile. Un accident, une maladie ou la vieillesse peut entraîner la perte de sa transparence, c'est la cataracte. Dans ce cas, il faut ôter chirurgicalement le cristallin et le remplacer par une lentille. L'il peut voir de nouveau mais sans accommodation.
Les défauts dioptriques de l'il
Un il dont la vue est normale est dit emmétrope sinon il est amétrope. On rencontre différents cas d'amétropie.
L'il myope : On dit que l'il est myope lorsqu'il ne peut pas voir avec netteté un point à l'infini même en accommodant. Le punctum remotum est à une distance finie. On peut considérer que l'il est trop grand pour son optique, car dans ce cas l'image est formée en avant de la rétine. La figure 3a nous montre un il myope observant un point éloigné (une étoile par exemple). En b nous voyons le parcours des rayons lumineux lorsqu'il observe un point à la plus grande distance où il peut voir net. Un myope est donc handicapé pour voir les objets éloignés et peut voir correctement de près. Il peut même voir de plus près qu'un il normal.
On compense la myopie avec des lunettes comportant des lentilles divergentes (figure 3c). Leur puissance doit être adaptée à l'importance de la myopie.
L'il hypermétrope : Dans ce cas l'il est trop petit pour son optique. Si l'affection est légère, il pourra voir nettement un objet éloigné en accommodant. Les difficultés augmentent en rapprochant l'objet.
L'image d'un objet éloigné est formée en arrière de la rétine (figure 4a). Le punctum remotum est virtuel.
On compense ce défaut avec une lentille convergente (figure 4c).
L'astigmatisme : Lorsque l'il est astigmate, il n'est pas possible d'améliorer la netteté avec des lentilles convergentes ou divergentes. La puissance dioptrique de l'il n'est pas la même pour toutes les parties de la pupille. Ainsi, par exemple, une "tranche" verticale de l'il fournit une image en arrière de la rétine alors qu'une "tranche" horizontale la fournit en avant.
Pour compenser l'astigmatisme on utilise des lentilles "déformées" dont la distance focale varie selon le diamètre concerné. Dans le cas le plus simple, et le plus fréquent, l'astigmatisme est dit "régulier". Il possède alors deux focales perpendiculaires. On le corrige à l'aide de verres cylindriques ou toriques.
Cette affection peut exister seule ou couplée à une myopie ou une hypermétropie.
La presbytie : Avec le vieillissement la faculté d'accommodation diminue progressivement, c'est la presbytie (figure 5). Elle concerne tous les humains emmétropes ou amétropes, elle n'est donc pas anormale.
Pour un emmétrope presbyte la vision de près peut être corrigée par le port d'un verre convergent. Cette correction est semblable à celle d'un hypermétrope pour la vision lointaine. Ceci provoque souvent une confusion entre presbytie et hypermétropie.
La perception des distances et du relief
Pour avoir une bonne connaissance de notre environnement, nous devons déterminer la distance des éléments qui nous entourent. C'est en interprétant la vision que notre cerveau obtient le plus d'informations à ce sujet. Pour apprécier le relief ou l'éloignement respectif des différents objets nous utilisons inconsciemment différentes méthodes, nous allons en étudier quelques unes.
La vision stéréoscopique : Pour que les images que nous percevons ne soient pas dédoublées, notre cerveau commande l'orientation des deux yeux afin de diriger leurs axes visuels sur le point observé. Ainsi, il peut fusionner les deux images.
Quand nous observons une scène très éloignée, les axes des yeux sont parallèles. Pour voir correctement un sujet proche, nous devons faire un effort pour les faire converger. L'intensité de cet effort nous renseigne sur la distance du point observé. Ainsi, nous percevons le relief. La vision avec les deux yeux est qualifiée de stéréoscopique. Elle donne plus d'informations qu'avec un seul il.
La figure 6 illustre cette méthode. Les traits pointillés matérialisent les axes visuels lors de l'observation lointaine. Ils sont parallèles. Pour observer le point P, le cerveau fait pivoter les yeux. L'intensité de la convergence ainsi réalisée nous renseigne sur l'éloignement du point observé.
Toutes les personnes n'apprécient pas le relief avec la même efficacité. Seulement 30% des humains perçoivent correctement le relief en vision stéréoscopique.
L'accommodation : Pour observer un objet très proche nous devons faire un effort d'accommodation dont l'intensité nous renseigne sur la distance.
Les ombres : Les ombres portées par les objets nous renseignent sur leur relief et sur leurs distances respectives. Ceci nous permet d'apprécier le relief sur des scènes très éloignées ou sur des photographies.
Ainsi, lorsque nous observons la lune au télescope, l'analyse des ombres nous renseigne intuitivement sur son relief.
Notre estimation du relief par cette méthode est très efficace, mais si nous ignorons la direction de la source lumineuse, nous pouvons être abusés et confondre un creux avec une bosse. Cette illusion est fréquente avec des photographies des planètes rapportées par les sondes spatiales. Dans ce cas, nous contemplons des paysages inconnus qui ne comportent aucun détail familier qui pourrait aider notre cerveau à comprendre la scène. Nous pouvons rectifier notre erreur en nous renseignant sur la direction du soleil au moment du cliché.
Certaines cartes géographiques indiquent le relief avec des ombres. Pour que les dénivellations soient bien interprétées l'éclairage vient du haut de la page, c'est à dire... du nord!
L'analyse des images : Nous analysons inconsciemment les scènes que nous voyons pour les modéliser dans notre esprit. Nous utilisons pour cela un grand nombre d'indices :
- Les objets éloignés apparaissent bleus à cause de l'atmosphère qui diffuse préférentiellement la lumière bleue. Ainsi, des montagnes situées à des distances différentes ne sont pas pareillement bleutées.
- Nos déplacements font mouvoir l'image visuelle des objets que nous observons. Ces changements de perspective nous renseignent sur les distances.
- Les règles architecturales que nous connaissons intuitivement (dans notre société) nous permettent de bien apprécier les formes et distances des édifices.
- Tous les objets familiers que nous voyons nous aident à interpréter nos images visuelles. La liste ne saurait être exhaustive.
L'il directeur
Peu après la naissance chacun de nous montre une préférence pour l'utilisation de certains membres, nous sommes droitiers ou gauchers. Il en va de même pour la vue, nous donnons plus d'importance à un il, c'est notre il directeur. C'est celui-ci que nous préférons utiliser pour tirer à la carabine ou pour observer dans un télescope.
Le plus souvent l'il directeur d'un droitier est à droite, et celui d'un gaucher à gauche. Mais ce n'est pas systématique.
Même si nos deux yeux semblent avoir les mêmes performances, nous savons mieux analyser les détails avec notre il directeur et, dans l'obscurité, il est souvent plus sensible que l'autre.
L'iris est la zone colorée de l'il (figure 2). En son centre, l'iris possède une ouverture qui a l'apparence d'un disque noir, c'est la pupille.
En fonction de l'éclairement ambiant, l'iris dilate ou contracte la pupille pour réguler la luminosité des images visuelles. En effet, c'est la pupille qui limite la largeur du faisceau lumineux qui pénètre dans l'il. Ainsi, une modification du diamètre pupillaire entraîne une variation de la luminosité de l'image.
La figure 7 illustre cette adaptation pour un individu moyen. En fait, dans des conditions identiques le diamètre pupillaire varie beaucoup d'une personne à l'autre, il peut varier du simple au double.
La dimension maximale de la pupille est affectée par le vieillissement. Les pupilles oculaires d'une personne âgée refusent de s'ouvrir autant que celles d'un jeune. Ceci explique pourquoi en vieillissant, un homme a besoin d'un éclairage plus intense pour être à l'aise.
La rétine est un tissu nerveux très mince qui tapisse le fond du globe oculaire (figure 1). Elle est composée d'une multitude de cellules photosensibles qui convertissent le stimulus lumineux en message électrique. Ce dernier est transmis au nerf optique. La rétine décompose donc l'image en un grand nombre de points. Ce capteur d'image comporte deux sortes de cellules photosensibles, les cônes et les bâtonnets.
Les cônes : Il existe trois types de cônes qui diffèrent par la couleur qu'ils perçoivent. Ils sont sensibles au bleu, au vert ou au rouge. Les couleurs que nous voyons provoquent un mélange de ces trois sensations. La rétine d'un il humain possède 6 à 7 millions de cônes.
Lorsque la luminosité ambiante est "confortable", ce sont les cônes qui sont employés par notre vision en fournissant des images colorées et détaillées surtout dans la fovéa. Dans ce cas, on parle de vision photopique.
Les bâtonnets : Ils sont 25 à 100 fois plus sensibles que les cônes, ils nous servent à voir dans la pénombre. Ainsi, grâce à eux nous pouvons voir malgré une très faible luminosité, c'est la vision scotopique. Dans ce cas nous ne percevons pas les couleurs car il n'y a qu'un seul type de bâtonnet. Un dicton nous le rappelle : "La nuit, tous les chats sont gris". Nous le constatons aisément en observant de nuit un paysage éclairé par la pleine lune, nous voyons sans apprécier les couleurs. Pourtant les couleurs sont là car la lumière réfléchie par la lune est celle du soleil. Notre il a 100 à 110 millions de bâtonnets.
Quand la pénombre est intermédiaire entre les conditions de la vision photopique et de la vision scotopique, on parle parfois de la vision mésopique ou de la vision crépusculaire.
La figure 8 nous montre les courbes de sensibilité spectrale des cellules photosensibles de l'il. Elles sont rapportées au même niveau. La courbe de sensibilité spectrale globale des cônes apparaît sur la figure 9a. Elle doit son aspect principalement aux cônes sensibles au rouge et au vert. Les cônes sensibles au bleu sont beaucoup moins performants. Ces dernières remarques sont illustrées sur la figure 9b qui montre la sensibilité spectrale relative des trois types de cônes. Remarquez que pour arriver à montrer dans la même figure les courbes de sensibilité spectrale des trois types de cônes, il a été indispensable d'adopter une échelle logarithmique sur l'axe vertical (%).
La nuit, le maximum de sensibilité de l'il est dans le bleu (507 nm). Le jour, il se situe dans le vert-jaune (555 nm).
Contrairement à une opinion répandue l'il n'est pas achromatique, il ne peut pas fournir une image nette simultanément pour les trois couleurs fondamentales bleu, vert et rouge. La netteté de la vision est due à la rapide décroissance de la sensibilité de part et d'autre du maximum.
La rétine est un très bon détecteur de lumière. Dans de bonnes conditions, elle fournit un signal pour quelques photons seulement. Seuls les meilleurs détecteurs électroniques peuvent faire mieux.
La répartition des cônes et des bâtonnets n'est pas uniforme sur la rétine. La papille, occupée par le départ du nerf optique, en est démunie, on l'appelle aussi la tache aveugle. Nous n'en avons pas conscience mais il est facile de la mettre en évidence.
La fovéa (voir figure 1) est située près de l'axe optique et reçoit donc les meilleures images. C'est une zone dans laquelle il y a une grande densité de cônes et peu de bâtonnets. C'est elle qui donne les images les plus fournies en détail et en couleurs, le reste de la rétine procure moins de détails. Pour examiner un objet, nous devons amener son image sur la fovéa. Pour cela, nous dirigeons notre regard vers lui.
La nuit, la fovéa est la zone de la rétine qui est la moins sensible.
Les bâtonnets sont plus denses sur la périphérie. Pour voir des objets de faible luminosité, nous devons donc les observer en "vision périphérique". Il ne faut surtout pas les fixer!
Certains individus n'ont pas une vision colorée normale car il manque à leur rétine une ou plusieurs sortes de cônes. Il s'agit d'une part des daltoniens qui confondent certains verts avec certains rouges et d'autre part des achromates qui ne différencient pas les couleurs.
Perception de l'intensité lumineuse : L'il est notre premier instrument de mesure de l'intensité lumineuse, il est intéressant de connaitre le comportement de sa sensibilité (ou plutôt de la sensibilité de la rétine) pour évaluer l'intensité des sources lumineuses.
D'une façon générale, les perceptions de nos sens sont proportionnelles au logarithme du stimulus physique. C'est Gustav Fechner (18011887) qui définit cette loi "La sensation varie comme le logarithme de l'excitation" que l'on peut aussi exprimer avec l'équation suivante :
Gustav Fechner avait établi cette relation en se basant sur les travaux de Ernst Weber (17951878) qui a notamment montré que la fraction suivante est constante :
Autrement dit, plus un stimulus physique est intense et moins on perçoit ses petites variations.
La rétine obéit à ces deux lois, c'est pour cela que les anciens grecs on imaginé une échelle des luminosités des étoiles qui suit une progression logarithmique des luminosités.
Pouvoir séparateur de l'il
Au niveau de la fovéa, l'aptitude à séparer des petits détails est limitée par la distance entre les cônes et par la qualité de l'optique de l'il.
Dans des conditions favorables, un il normal peut séparer deux points distants de 1 minute d'arc. C'est à dire qu'il va voir séparément deux points situés à 3,4 mètres de lui et espacés de 1 millimètre. Les services médicaux lui donnent alors une note de dix dixièmes. Des personnes jouissant d'une très bonne vue obtiennent des notes supérieures.
Notez que cette performance est liée à la qualité de l'éclairement de la scène observée.
Précautions à prendre
La rétine est fragile. Un fort éblouissement peut l'endommager. Si nous forçons notre il à regarder le soleil directement pendant un long moment, nous perdons irrémédiablement des cellules de la rétine. Si cet "exercice" est de courte durée et n'est pas répété, les dégâts seront infimes. Dans le cas contraire, nous assisterions à une dégradation progressive des performances de la vue.
L'observation du soleil avec une lunette ou un télescope est donc dangereuse. Dans ce cas, si nous n'utilisons aucune protection la cécité sera immédiate et irréversible!
GALILÉE (Galileo Galilei, 1564 - 1642) fut le premier à contempler le ciel avec une lunette qui était un appareil primitif avec un petit objectif de deux centimètres de diamètre environ. Ce grand astronome observa le soleil avec son instrument sans précaution particulière. Il est probable que c'est pour cela qu'il est devenu aveugle.
Une autre source d'accidents est constituée par les générateurs de faisceau LASER. Ces instruments sont de plus en plus répandus. Ils sont utilisés notamment par des conférenciers pour désigner un point sur un écran de projection. Lorsqu'un tel faisceau est dirigé vers un il, il forme sur la rétine un point brillant où la lumière est si intense qu'elle provoque instantanément une destruction des cellules. La constitution d'un seul point aveugle est indolore et n'est pas dramatique, elle passera probablement inaperçue. Mais en cas de répétitions de cette mésaventure, la détérioration de la vue est certaine et préoccupante.
L'accoutumance
Quand nous arrivons en un lieu obscur, nos yeux s'adaptent. Tout d'abord nos pupilles se dilatent. Ceci peut prendre quelques secondes.
La rétine évolue dans l'obscurité. Sa sensibilité s'accroît progressivement. Elle nécessite une heure, pour atteindre son accoutumance maximale.
La figure 10 indique la plus faible lumière visible en fonction du temps passé dans l'obscurité.
Un il normal bien adapté à la vision nocturne est capable de voir des étoiles de sixième magnitude. Avec un ciel de très bonne qualité, certains voient à l'il nu des étoiles de magnitude supérieure à 7.
Cette adaptation disparaît rapidement au moindre éblouissement. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser d'éclairage violent pendant une observation astronomique nocturne. Lors d'une telle séance, et en cas de nécessité, il faut utiliser une source de lumière si faible qu'elle ne permette pas la perception des couleurs. Elle sera verte de préférence. Il faut éviter la lumière rouge car l'il est très peu performant pour cette teinte. On doit alors utiliser un éclairage relativement intense pour voir des détails. Ceci est préjudiciable à l'accoutumance de la rétine et aux éventuelles pellicules photographiques utilisées à ce moment.
Les observateurs nocturnes craignent beaucoup les fumeurs avec leur cigarette brillante et leur imprévisible briquet.
L'adaptation de l'il à l'obscurité entraîne habituellement une augmentation de sa distance focale et une diminution de son aptitude d'accommodation (myopie et presbytie nocturnes).
Dans l'obscurité nous utilisons surtout la vision périphérique qui est peu détaillée. Pour bien voir, nous devons donc nous rapprocher plus des objets. Nous pouvons utiliser avec profit des jumelles lumineuses (exemple : 7 x 50).
Le choix des instruments d'observation nocturne
Les jumelles : De jour, comme de nuit, les jumelles fournissent de superbes images. Leur faible grossissement nous permet de les utiliser sans support.
Les modèles à prismes de Porro ont des objectifs qui sont plus écartés que les yeux de l'observateur. Cette disposition permet une meilleure appréciation du relief et des distances des objets éloignés.
Les jumelles fournissent des images lumineuses. Pour profiter au mieux de cette clarté, nos pupilles oculaires devront avoir un diamètre supérieur à celui des pupilles de sortie de l'instrument utilisé. Dans le cas contraire, cela reviendrait à utiliser un instrument de diamètre moindre.
Pour une utilisation nocturne, nous devons choisir un modèle particulièrement lumineux. Nous préférons utiliser des 7 x 50, elles ont un grossissement de 7 fois et un diamètre de 50mm. Un grossissement supérieur impose l'utilisation d'un support stable. Cet instrument a une pupille de sortie de 7 millimètres de diamètre, c'est très intéressant pour un jeune adulte.
Il en va autrement pour un observateur âgé de plus de cinquante ans. En effet, ses pupilles oculaires auront une taille inférieure allant jusqu'à trois ou quatre millimètres de diamètre maximal. Il ne profitera donc jamais de toute la luminosité de cet appareil. En conséquence, il pourra se limiter à des jumelles de 7 x 35 qui ont une pupille de sortie de cinq millimètres.
Le grossissement minimal d'un instrument : Il existe un grossissement minimal en dessous duquel il n'est pas intéressant d'utiliser une lunette ou un télescope. On considère généralement que c'est le grossissement qui fournit une pupille de sortie de six millimètres de diamètre. Dans ce cas, notre il profite de l'intégralité de la lumière qui pénètre dans l'instrument (observation nocturne).
Exemples :
Bien entendu, pour une personne âgée ces valeurs doivent être modifiées. Il faut dans ce cas rechercher un pupille de sortie de trois ou quatre millimètres de diamètre.
Le grossissement maximal d'un instrument : De même, il existe aussi une limite maximale au grossissement. En effet, si le faisceau lumineux qui entre dans l'il est trop étroit, il est dispersé par les défauts de la cornée et du cristallin. La limite généralement admise est 0,4 millimètre. Heureusement, le grossissement correspondant est largement suffisant pour nous permettre de voir tous les détails que donne l'objectif.
Exemples :
- une lunette de 60 mm devra être utilisée avec un grossissement inférieur ou égal à 150 fois.
Le grossissement résolvant (appelé aussi grossissement utile) : C'est le grossissement qui permet à un il normal d'apprécier tous les détails fournis par l'objectif. Ainsi, un télescope de 12cm de diamètre sépare des détails de 1 seconde d'arc. Avec un grossissement de 60 fois, il nous montre ces détails avec un écart d'une minute d'arc. Ceci permet donc à un il normal de les distinguer.
Par convention, pour définir le grossissement résolvant, on prend une marge de sécurité et on considère que l'il a un pouvoir séparateur de 2 minutes d'arc. Ainsi dans notre exemple le grossissement résolvant est de 120 fois. Ce grossissement résolvant d'un télescope ou d'une lunette est numériquement égal au diamètre de l'instrument exprimé en millimètres. Notez que cette définition varie selon les auteurs.
Nous n'avons pas évoqué les performances des oculaires, pourtant ceux-ci limitent dans de nombreux cas la finesse des détails que peut percevoir l'il de l'observateur. Si vous êtes intéressés par ce sujet nous vous proposons le logiciel CORRECT 3.
Position de l'il
La pupille de sortie d'un télescope est l'image de l'objectif formée par l'oculaire. Elle se situe à quelques millimètres en arrière de ce dernier, et doit être placée au centre de l'iris de l'il de l'observateur. Suivant la qualité de l'oculaire cette position sera plus ou moins rapidement inconfortable. Nous préférons les oculaires qui sont en contact avec le sourcil quand l'il est bien placé (ex : oculaires de la marque CLAVE).
C'est dans cette position que l'il percevra la meilleure image. C'est à dire l'image la plus lumineuse, la plus fine et la plus étendue.
Les porteurs de lunettes
Ceux-ci devront les ôter pour pouvoir placer convenablement leur il. Ils compenseront leur défaut optique en ajustant la mise au point.
Seuls les astigmates devront garder leurs lunettes, surtout pour les faibles grossissements. Pour les forts grossissements, ils devraient pouvoir s'en passer.
Position de l'image
L'image du détail analysé doit être placée au centre du champ de l'oculaire. Sinon, elle sera affectée par les aberrations extra axiales de l'instrument. Hélas, il n'est pas rare de voir l'utilisateur d'un télescope de qualité qui observe saturne au bord du champ. Dans ces conditions, la finesse de l'image vue est très fortement dégradée.
Vous pouvez vérifier cette affirmation avec le logiciel
CORRECT 3.
Conditions de l'observation
La qualité de notre vision dépend aussi du confort. Quand c'est possible, il faut choisir une position stable et agréable.
Il faut éviter le bruit. L'observation visuelle est une activité intellectuelle, la rétine fait même partie du système nerveux central, et il est démontré que pour ce type d'activité, l'être humain est plus performant dans le silence.
L'appréciation des détails
L'image télescopique est petite et agitée par la turbulence atmosphérique. Les nouveaux observateurs sont rapidement déçus.
Il faut apprendre à voir les détails fugaces de cette image. La meilleure méthode d'apprentissage est sans doute le dessin. Après avoir réalisé quelques croquis de Saturne ou de Jupiter le novice constatera que l'acuité de sa vue s'est améliorée dans de grandes proportions.
Lors des séances d'observation en public, certains participants partent avec des idées très négatives sur l'intérêt de l'observation visuelle. Il faut les sensibiliser à cet apprentissage.
La vision des objets lumineux
Les novices sont parfois étonnants. Certains ne voient même pas le soleil dans le champ d'un instrument. Il semble que cela est dû aux préjugés de l'observateur.
En général, on arrive à "rendre la vue" au débutant en lui demandant de décrire ce qu'il regarde.
La vision des objets de faible luminosité
Elle dépend, bien entendu, de la sensibilité de l'il de l'observateur mais aussi de ses idées. En effet, un observateur peut chercher avec ses jumelles la nébuleuse North-America et ne pas la trouver. Il pourra même essayer un grand nombre de fois. Et une nuit il la verra enfin. Il réalisera alors qu'il l'apercevait depuis le début de ses essais mais il croyait ne pas la voir car elle ne ressemble pas à l'idée qu'il s'en faisait.
A l'inverse, à force de vouloir apercevoir un objet faible on finit par le voir, alors qu'il n'existe pas. Seuls, les "yeux de la foi" permettent cet exploit.
Ne l'oublions pas, même à l'oculaire, les objets faibles sont mieux vus en vision périphérique. C'est à cela que NGC 6826 doit son surnom de "nébuleuse clignotante". Quand on l'observe dans le champ d'un télescope, on la voit en vision périphérique, mais elle disparaît quand on la fixe.
La couleur des nébuleuses
Certains objets nébuleux sont assez brillants pour que l'on puisse apprécier leur couleur. Lorsque ces objets sont gazeux, ils émettent un ensemble de raies spectrales dont certaines sont justes à la frontière de la sensibilité chromatique de certains cônes. La couleur perçue variera selon les circonstances et les individus.
Ainsi, quand elle est observée au télescope, M42, la grande nébuleuse d'Orion, peut paraître verte pour certains, bleue pour d'autres et grise pour ceux qui n'ont pas la vue assez sensible pour la voir en couleurs.
Les estimations d'éclat
Les spécialistes des étoiles variables doivent être informés de quelques particularités de notre vision.
Il est difficile de comparer l'éclat de deux étoiles brillantes. Leurs images éblouissent localement la rétine. Dans ce cas, il peut être intéressant de "défocaliser" les images et faire la comparaison entre deux images floues.
Si deux étoiles, dans le champ d'un instrument, ont le même éclat, certains observateurs diront que celle de droite est plus brillante. D'autres diront l'inverse.
Les étoiles rouges semblent de plus en plus brillantes quand on les observe. Il faut donc estimer rapidement leur éclat.
Visitez le site du Syndicat National des Ophtalmologistes de France. Vous trouverez une base de données sur les caractéristiques de la vision humaine sur le site du "Colour & Vision Research laboratory" en langue anglaise.
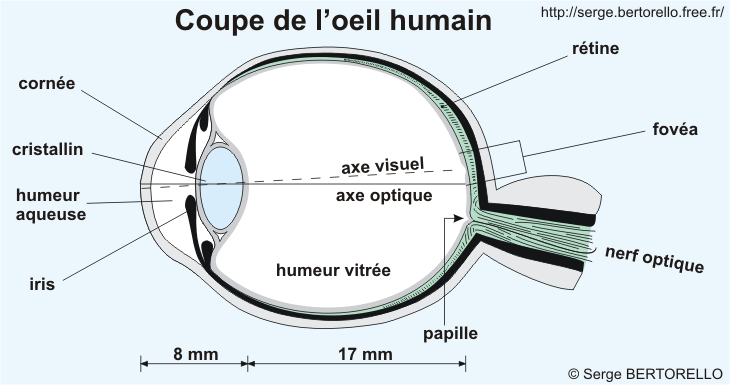
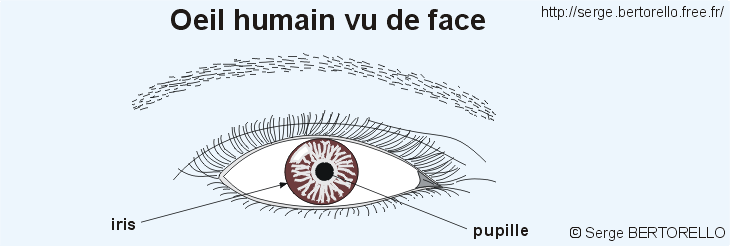




Cette information n'est pas très précise mais nous en tenons compte.




avec :
S = sensation perçue
I = intensité de la stimulation
k = constante

avec :
ΔI = plus petite différence d'intensité perçue
I = intensité de la stimulation
k = constante
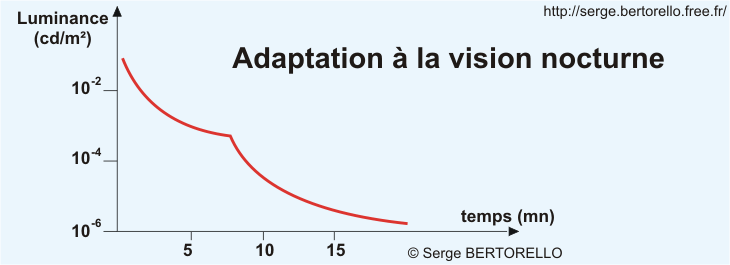

- une lunette de 60 mm devra être utilisée avec un grossissement supérieur ou égal à 10 fois.
- un télescope de 150 mm devra être utilisé avec un grossissement supérieur ou égal à 25 fois.Grossissement maxi = (diamètre de l'objectif en millimètres) x 2,5
- un télescope de 150 mm devra être utilisé avec un grossissement inférieur ou égal à 375 fois.