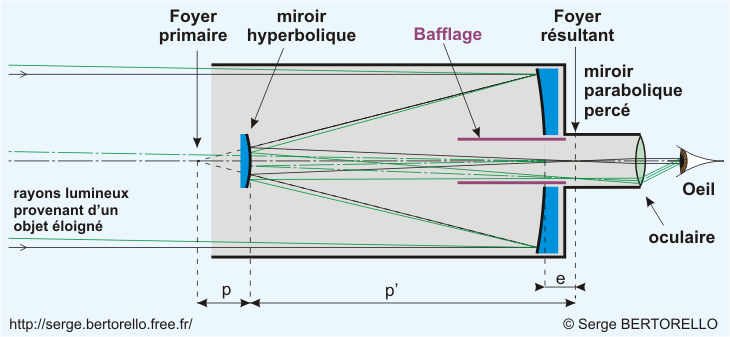NOTIONS D'OPTIQUE
En 1672, quelques semaines après que Newton eu présenté son nouvel instrument d'observation, un français de la région de Chartres et se faisant appeler Cassegrain a publié la description d'un autre type de télescope.
Qui était ce Cassegrain? Selon les auteurs, il se prénommait Jean, Nicolas, Guillaume ou Laurent... mais la plupart écrivent seulement le nom de Cassegrain sans préciser de prénom. Certains affirment même que l'inventeur du télescope de Cassegrain portait un nom différent.
Ce système optique a été "méchamment" dénigré par Newton ainsi que par Huygens (Christiaan Huygens 1629 - 1695). Son auteur écrasé par la grande autorité de ces physiciens de renom a probablement été tenté de se faire oublier... Peut-être est-ce là l'origine des incertitudes sur la désignation de l'inventeur de ce télescope.
J'aimerais profiter de cette occasion pour critiquer l'attitude des auteurs qui rapportent les écrits d'autres rédacteurs sans chercher à vérifier les informations (je n'imagine pas être moi-même complètement à l'abri de cette critique mais je fais des efforts pour éviter de diffuser des informations que je n'ai pas vérifiées). Cette pratique conduit parfois à propager à travers le temps des "vérités" qui n'en sont pas, je connais plusieurs exemples. Lecteurs, soyez donc vigilants.
André Baranne ingénieur opticien à l'observatoire de Marseille et Françoise Launay ingénieur à l'observatoire de Paris-Meudon ont réalisé une enquête digne de Sherlock Holmes pour identifier ce personnage et ils ont publié les résultats de cette recherche dans le "Journal of Optics" (1997, vol. 28, n°4, p. 158-172). Ils ont conclu qu'il s'agissait du discret Laurent CASSEGRAIN prêtre et professeur au collège Pocquet de Chartres né en 1629 dans la région de Chartres et mort à Chaudon dans l'Eure et Loir le 31 Août 1693.
Selon la description de Laurent CASSEGRAIN, ce télescope est composé de deux miroirs disposés sur le même axe. L'image fournie par le miroir primaire concave est agrandie par le secondaire convexe (mais sans être redressée) et projetée à travers un trou percé au centre du miroir principal.
Dans le cas du télescope de Cassegrain, l'image projetée par le miroir principal parabolique n'existe pas réellement car le miroir secondaire intercepte les rayons lumineux avant le foyer primaire. Cette image est virtuelle.
Le miroir secondaire convexe et hyperbolique projette cette image virtuelle vers le foyer résultant en l'agrandissant dans le rapport p'/p. Une image réelle se forme au foyer résultant et elle est analysée avec l'oculaire.
Dans les formules suivantes qui décrivent le télescope de Cassegrain, toutes les longueurs doivent être exprimées avec un signe positif. Nous considérons aussi que le foyer se situe après la surface réfléchissante du miroir principal à la distance de dégagement "e".
Calculons tout d'abord la position du miroir secondaire :
D2 est le diamètre du miroir secondaire, D1 est le diamètre du miroir primaire. La formule suivante nous indique la valeur minimale de D2. En fait, il faut lui donner une valeur légèrement supérieure pour avoir un champ de pleine lumière non nul :
Comme nous l'avons évoqué précédemment, le miroir primaire du Cassegrain est parabolique, son coefficient de déformation b1 est donc égal à -1. Nous pouvons calculer le coefficient de déformation b2 du secondaire avec la formule suivante :
L'encombrement du télescope de Cassegrain est plus faible que celui du Gregory.
Considérons par exemple un télescope de Cassegrain dont le miroir primaire est ouvert à F/D=3 et dont le miroir secondaire agrandit 5x l'image. Cet instrument a donc un rapport d'ouverture résultant F/D=15 mais il aura approximativement le même encombrement qu'un télescope de Newton de même diamètre et ouvert seulement à F/D=3. La combinaison de Cassegrain permet donc d'obtenir une grande distance focale sous un encombrement très réduit.
Le télescope de Cassegrain est particulièrement apprécié pour l'observation des planètes et des étoiles doubles. En effet, sa grande distance focale permet d'obtenir des forts grossissements avec des oculaires de moyenne puissance qui sont souvent de meilleure qualité que les oculaires puissants.
La coma du télescope de Cassegrain est équivalente à celle d'un télescope de Newton de même distance focale. Elle est donc peu perceptible sur les télescopes de Cassegrain dont le rapport F/D est habituellement situé entre 15 et 30.
L'astigmatisme du télescope de Cassegrain dépend de sa configuration. Dans les cas usuels, il est 2 à 10 fois plus important que celui d'un télescope de Newton de même distance focale. La formule suivante nous permet de d'étudier son coefficient d'astigmatisme A à partir de la distance focale du primaire f1, de la distance focale résultante F et du dégagement du foyer e :
Ces aberrations extra-axiales ne sont toutefois pas handicapantes pour cette formule optique car on ne l'emploie pas pour l'observation des astres étendus.
Comme pour le télescope de Gregory, un bafflage est nécessaire pour empêcher l'entrée directe de la lumière dans l'oculaire car cela dégraderait le contraste. Sur le télescope de Cassegrain, ce bafflage manque d'efficacité car il ne peut être placé que du côté du miroir principal. Ceci explique le manque de contraste flagrant que l'on constate sur certains télescopes de Cassegrain quand ils sont employés de jour ou pendant le crépuscule ou alors pour observer un astre à proximité de la Lune ou du Soleil.
L'imagination a conduit des opticiens à concevoir diverses variantes de la formule de Cassegrain. On peut évoquer, comme exemple, une configuration avec des miroirs excentrés qui fournit une image sans la moindre obstruction mais la mise en pratique de cette solution est malaisée et présente peu d'intérêt. Elle n'a pas eu de succès.
En fait, la combinaison dérivée du Cassegrain qui est la plus utilisée est celle qu'a conçue le français Henri Chrétien (1879 - 1956) et dont le premier exemplaire a été construit par l'américain George Willis Ritchey (1864 - 1945). L'usage lui a consacré le nom de "télescope Ritchey-Chrétien" (voir plus loin).
L'accès à l'oculaire d'un télescope de Cassegrain peut être difficile car certaines directions de visée peuvent le placer en des positions inaccessibles. Pour éviter les "orientations impossibles" on peut disposer ce télescope sur une monture allemande mais cela n'empêchera pas d'être contraint à des contorsions notamment pour les observations au zénith.
C'est pour améliorer le confort d'utilisation du télescope de Cassegrain que James Nasmyth a ajouté un miroir plan à cette combinaison pour renvoyer l'image dans l'axe horizontal de sa monture azimutale.
James Nasmyth était un ingénieur (et astronome amateur) écossais né en 1808 à Edimbourg et mort en 1890 à Londres. Il est l'auteur de nombreuses inventions.
La disposition proposée par James Nasmyth ne change pas le principe du télescope de Cassegrain mais elle évite la nécessité de trouer le miroir primaire. Elle est très souvent adoptée aujourd'hui sur les plus grands télescopes. On dit que l'on observe l'image au foyer Nasmyth.
Il faut noter cependant que le nombre de réflexion est impair (il y a trois réflexions). Ainsi, l'image focale est inversée de sorte que l'image d'une main droite ressemble à une main gauche. Cela peut perturber la comparaison de l'image avec une photographie ou une carte.
 [27]
[27]
 est le rayon de courbure du miroir secondaire :
est le rayon de courbure du miroir secondaire :
 [28]
[28]
 [29]
[29]

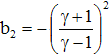 [30]
[30]
 [31]
[31]

Ainsi l'image est toujours accessible quelle que soit l'orientation de l'instrument.